Parmi les cadeaux offerts au public à l'époque des fêtes, nul ne s'étonne de trouver quelques-uns des chefs-d'œuvre de Lubitsch, tant il est usuel d'associer son cinéma à une promesse de bonheur. Mais en quoi consiste au juste ce bonheur ? Et pourquoi le regardons-nous aujourd'hui comme un paradis perdu du cinéma, dont la porte nous serait fermée ? Peut-être une séquence fugitive de ce Trouble in Paradise, si tristement traduit par Haute pègre, nous aidera-t-elle à le comprendre.
L'épisode se situe au moment où la milliardaire Mariette Collet reçoit ceux qui prétendent lui rapporter son sac perdu à l'opéra. De la foule des petites gens que l'espoir de la récompense a réunies dans son hall surgit un grand escogriffe à l'œil noir et à la tignasse broussailleuse. Il ne vient pas proposer un sac. Il vient stigmatiser, citation de Trotsky, à l'appui, cette femme dont le sac est couvert de diamants au prix fabuleux. Un autre intrus ouvre alors la porte : c'est l'escroc Gaston Monescu, alias Monsieur Le Val, qui vient rapporter, pour toucher les 20 000 francs promis, le sac qu'il avait lui-même volé. En quelques mots russes, il signifie au perturbateur qu'il ennuie la dame et a intérêt à s'en aller.
La chose peut sembler aller de soi : ce trotskiste échevelé n'est pas à sa place dans le salon de l'exquise et richissime Madame Collet et, après avoir amusé quelques secondes la galerie, il doit disparaître pour que s'engage la grande partie d'escroquerie et de séduction. Cette sortie ne sert pas seulement l'intérêt du personnage, mais aussi celle de l'art. L'art vit d'apparences et celui de Lubitsch au suprême degré. Kant enseignait déjà que, pour jouir esthétiquement de la forme d'un palais, il fallait suspendre toute considération morale sur la vanité des oisifs qui s'y logent en exploitant le travail des pauvres. Pour jouir de la merveilleuse ambiguïté du jeu de l'escroc amoureux avec sa victime cynique, il faut mettre à la porte toute considération sur l'origine de l'argent qui paye les folies de Madame Collet et fait la convoitise de son séducteur.
Mais il y a quelque chose de plus singulier dans cette séquence. Pourquoi Gaston, qui n'est pas censé connaître l'énergumène et n'a pas entendu sa diatribe, s'adresse-t-il à lui en russe ? Cet aparté linguistique transforme l'expulsion de l'intrus en une connivence secrète. Comme si, plus que Gaston, c'était Lubitsch qui s'adressait au champion de la lutte des classes, c'est-à-dire à celui qui dit la vérité sur les apparences sociales, pour lui répondre à peu près ceci : « Je sais ce que tu as à dire sur mes personnages. Je pourrais moi aussi le dire. Et d'ailleurs je vais le faire à ma manière en étalant le spectacle de ce monde où il n'y a que des voleurs, à l'exception de l'innocente milliardaire qui n'a besoin de voler personne en particulier puisque le système organise pour elle le vol. Mais cette manière précisément exclut la tienne, qui dénonce la vanité de ce monde d'apparences au nom de la réalité de dehors, de la vérité de l'exploitation qui soutient cette apparence. L'un de nous deux est ici de trop. Et comme je suis chez moi, au cinéma, c'est à toi de sortir. »
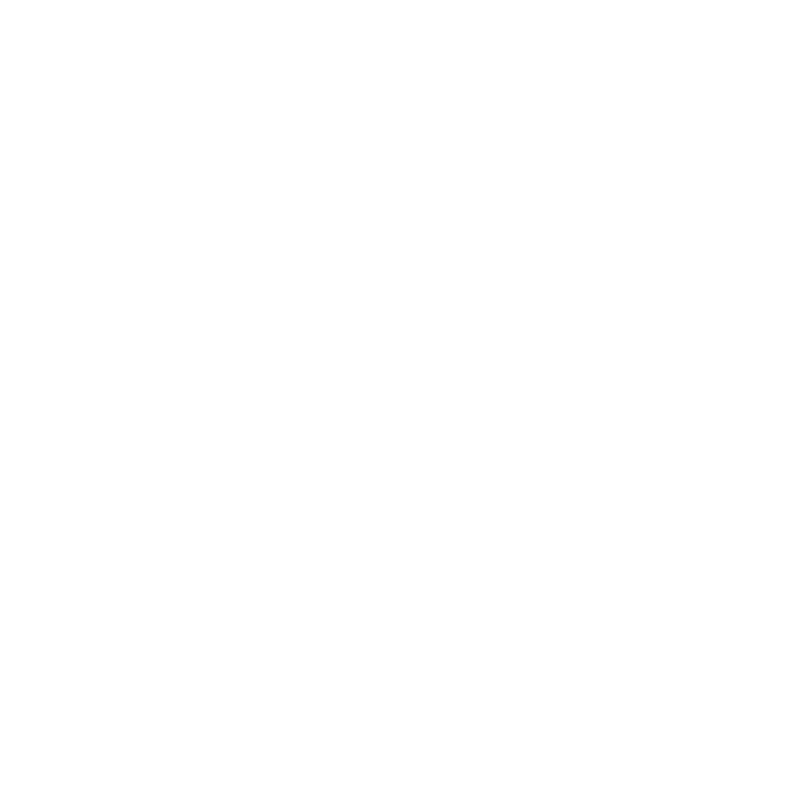
L'alternative alors est bien une connivence. Mettre à la porte le marxiste – celui qui dit la vérité sur les apparences, c'est l'instaurer en gardien de cette porte. Contre qui la garde-t-il ? La réponse est claire : contre la foule des prétendants qui se pressait dans le hall, contre les représentants ordinaires de la comédie sociale, ces « Messieurs Dames » dont parle Mallarmé, toujours prêts à proposer leur marchandise et leur personne, à transformer l'écran ou la scène en miroirs où ils aiment à reconnaître leurs traits et leurs manières. Le gardien du vrai doit expulser cette foule des prétendants pour que le magicien des apparences puisse instaurer sa propre logique qui fait coup double avec la grande loi économique de l'équivalence. D'un côté, le vrai et le faux ne se laissent plus distinguer en rien. Toute parole et tout geste de l'escroc calculateur sont en même temps des gestes et des paroles d'amoureux et toute crédulité de la victime une complicité cynique de celle qui peut tout acheter. De l'autre, le jeu de l'équivalence avoue sa vérité : dans les eaux glacées du calcul égoïste, toute ambiguïté de séduction amoureuse se ramène en dernière instance à l'indifférence de l'équivalent monétaire. Ainsi l'art de l'illusionniste ne joue pas contre la science militante. Il partage avec elle les rôles. La puissance du jeu des apparences dans la maison Collet est égale à la puissance de la vérité – de la lutte des classes – qui se tient derrière la porte.
Cette solidarité permet d'éclairer par contraste quelques problèmes actuels de notre cinéma. Quand la lutte des classes n'est plus derrière la porte, quand on proclame la fin de l'histoire et de la politique, c'est alors la foule des prétendants gui passe la porte. C'est la comédie sociale, les jeux de famille et de société de la ressemblance gui envahissent l'écran. Alors les faits mêmes de la violence sociale semblent flotter en l'air, sans trouver de corps plausibles pour les incarner sur l'écran. Et, en même temps, c'est l'art des apparences qui apparaît comme un paradis à jamais perdu. Deux films récents en témoignent. Dans Selon Matthieu, le scénario de la violence de classe semble planer au-dessus des personnages comme une abstraction qui rend superflue toute incarnation particulière. Pourtant l'histoire du père frappé à mort par son licenciement et les mots des personnages disent une situation que nous reconnaissons comme bien réelle : le règne sauvage du marché, les vies brisées par des licenciements qui font, en revanche, monter le cours des actions de l'entreprise, etc. Mais quand la vérité n'est plus derrière la porte, quand elle est connue de tous, semblable à ce qui se répète toutes les demi-heures sur les bulletins d'information, elle n'a plus pour cette raison même aucune voix particulière pour l'incarner. Les corps courent alors après des mots qui flottent et qu'ils ne peuvent retenir. Et l'on partage devant les vains éclats de voix de Matthieu l'exaspération de son frère. Tous les plans forts du film sont des plans muets : le patron qui passe sans sembler le voir devant le père qui fume en contravention avec le règlement ; la traînée de sang au milieu du carrefour barré, et ce corps caché sous une couverture que les policiers emmènent, celui du père, mort de l'injustice subie ; les gestes méticuleux du fils qui lisse la tombe de marbre noir comme on nettoie des carreaux ; le regard muet de Matthieu au moment de la rupture avec la femme du patron séduite par vengeance ; le rodéo final qui vide la querelle du fils révolté et du fils soumis. C'est le mutisme qui a le dernier mot. Et avec lui la mer, le ciel et la musique.
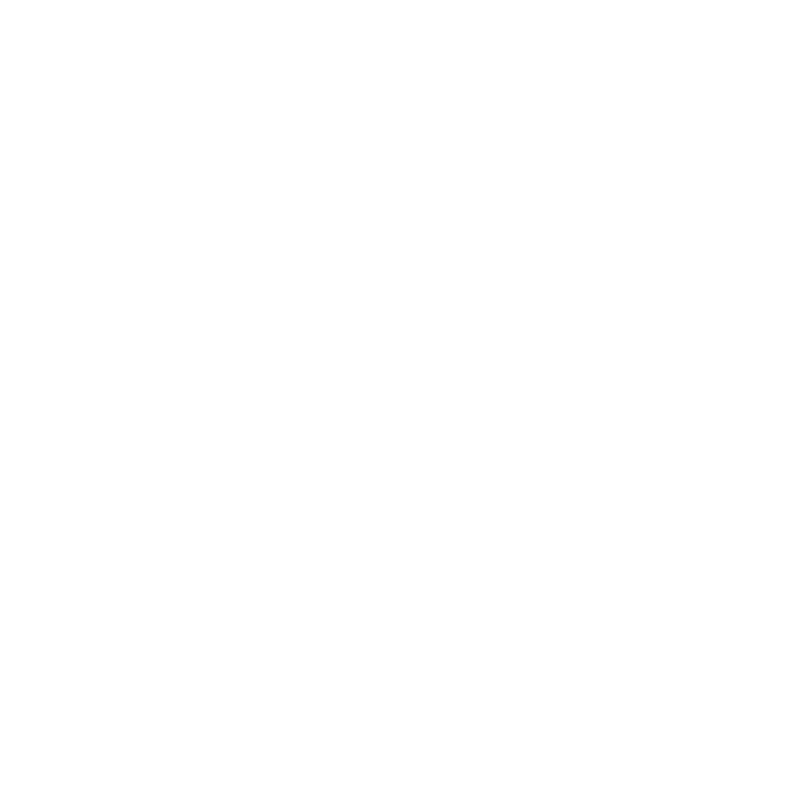
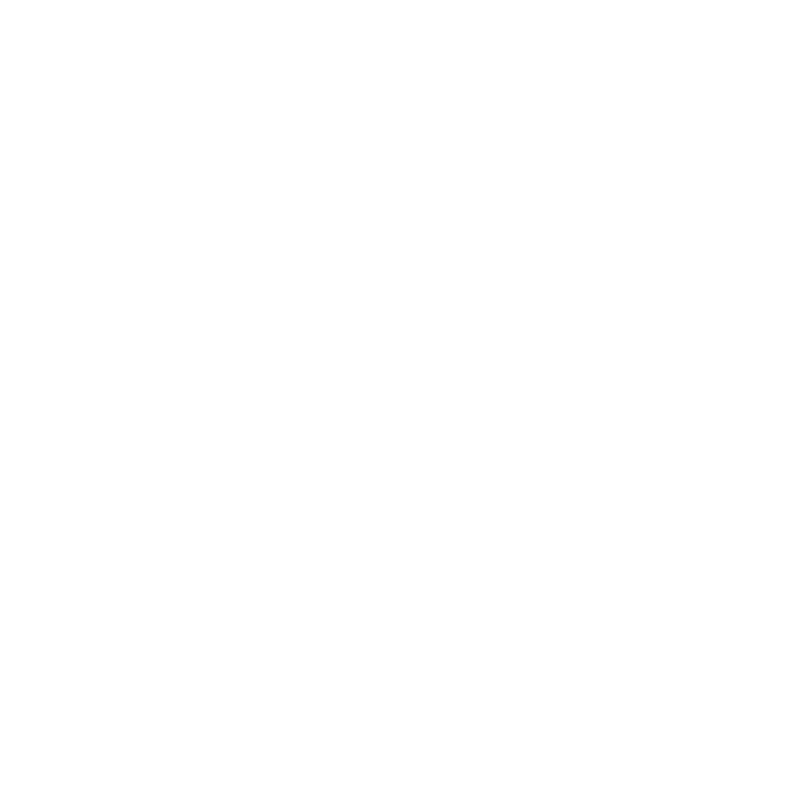
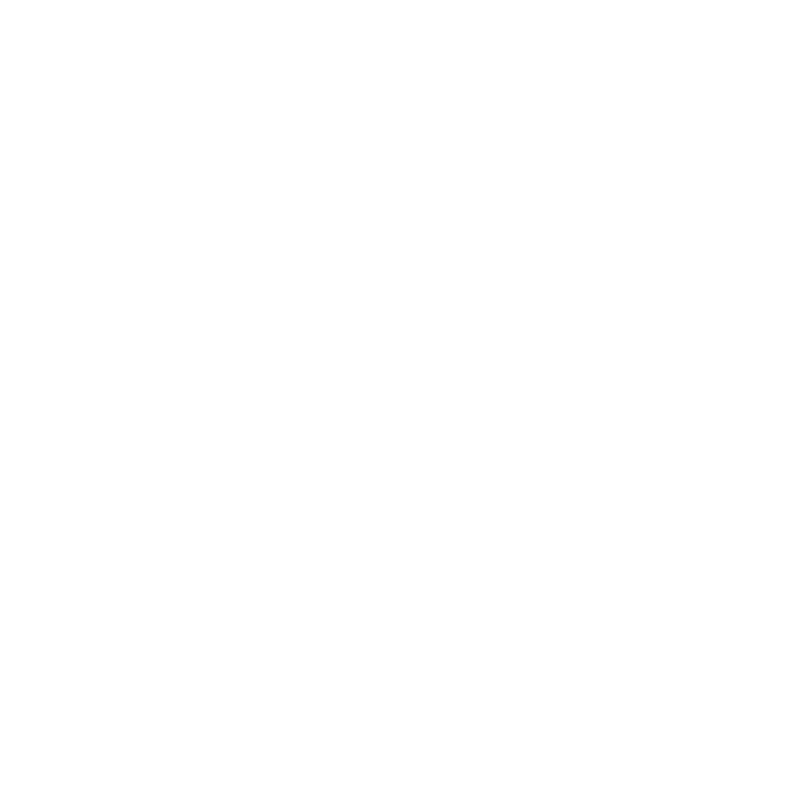
Ce sont eux encore qui ont le dernier mot dans Sous le sable. Assurément le film ne se soucie pas de questions sociales. Ce dont il se soucie en revanche, c'est des ombres de l'art. Et si la référence à L'Avventura s'impose évidemment dans ce scénario inversé de disparition, c'est aussi le charme évanoui de l'escamoteur Gaston Monescu gue l'on évoque devant cette figure de séducteur qui met en œuvre quelque chose comme l’Anabac du candidat aux succès féminins : pour séduire une femme, il faut et il suffit de lui montrer qu'on la désire. Comme le lui dira la séduite, il ne fait pas le poids. Moins en tout cas que cet ours de mari corpulent et taciturne qui a utilisé l'arme suprême de la séduction: disparaître sans laisser de trace, s'évanouir dans le grand vide de l'Océan, pour reparaître en ombre complice. La seule chance qui resterait au séducteur besogneux serait de se trouver à l'épisode final sur la plage dans la figure de cette silhouette non identifiable qui est pour la femme la silhouette du disparu désirable, pour nous la séduction de l'ombre cinématographique, évanouie peut-être avec la vérité qui la gardait. Le filin est comme la fable d'un cinéma contemporain privé de gardien et qui s'efforce désespérément de retrouver, à coup de corps escamotés et de de visages mutiques, le paradis perdu des apparences.
La mer, le ciel et la grande musique ouvrent et ferment également La ville est tranquille. Et sans doute ce film est-il celui qui met le mieux en évidence le jeu dialectique de la vérité sociale et de l'apparence cinématographique. Plus que tout autre, Guédiguian a fait de la lutte des classes et de son effacement le sujet de ses films. Et il s'est par là exposé au reproche majeur, celui de confondre l'art des ombres cinématographiques avec le sermon idéologique et d'encombrer avec les mots de la politique des corps qui n'en ont rien à faire. C'est ainsi qu'il faisait du petit monde d'opérette de Marius et Jeannette un échantillon d'un peuple à l'ancienne, incluant même, comme il se doit, sa contradiction au sein du peuple : un partisan du Front national. La ville est tranquille semble construit pour répondre à ce défi : faire du cinéma avec l'état présent du social, rendre plausible dans la singularité de corps filmès cet état qui ne cesse de se diluer dans les mots convenus qui déclarent la fin de toutes les grandes oppositions. Corps vivants mutiques et corps morts emportés sous des draps se bousculent exemplairement dans le film. Mais plutôt que de subir l'écartèlement des mots et des corps, le cinéaste a choisi de le construire, en structurant le film selon un système de deux grands écarts qui affectent simultanément le visible des corps et la parole sur l'état du monde. C'est d'abord le grand écart entre les longs panoramiques sur la ville, accompagnés par les tubes de la musique réconciliatrice (La Marche turque, Que ma joie demeure, etc.) et les petits drames, qui mettent en jeu des gestes microscopiques effectués par des corps fragmentés pour d'autres corps fragmentés. On pense au viseur du fusil du tueur à gages, mais surtout, bien sûr, à ces gros plans où les mains de la mère, sur la table de change du bébé, préparent la drogue pour le corps geignant de sa fille dont la tête et le bras couvert de traces de piqûre émergent à peine d'une montagne de poils de mohair rouge, et à l'hésitation de ces mains au moment d'ajouter le supplément mortel qui arrachera le dernier « merci » de ce corps quasi mutique. Dans le même temps, un deuxième écart casse en deux le discours ambiant sur la fin de la lutte des classes, de l'histoire, et de toute utopie. Il le répartit à deux extrêmes : d'un côté, le discours sans fin de l'urbaniste socialiste beau parleur – autre figure de séducteur dérisoire – ou de la militante du retour aux forêts primitives de la vie ; de l'autre, borné par le mutisme radical du tueur à gages, le mouvement qui ralentit et raréfie la parole de l'ancien docker syndicaliste, devenu chauffeur de taxi. Quand celui-ci se met, pour dérider la mère humiliée, à entonner en toutes les langues les couplets de L'Internationale, quelque chose vient rappeler, avec les facéties des corps lubitschiens, l'ancienne alliance entre les gardiens du vrai et les magiciens de l'apparence. Ces moments de bonheur s'avouent vite comme payés au plus haut prix. Et quand les couleurs de la ville se dissiperont dans le blanc final, c'est La Marche turque qui viendra proposer à leur place un enjouement peut-être un peu trop mécanique.
Jacques Rancière, Cahiers du Cinéma 554 (février 2001)

